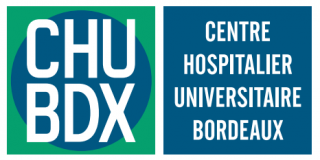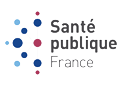Nomination du CNRCH 2023-2027
Le Laboratoire de Bactériologie de l’Hôpital des Enfants de Bordeaux a été l’un des premiers en France à s’intéresser aux Campylobacters en 1979. Durant les années 80, nous avons mené plusieurs études sur le rôle des Campylobacters dans les diarrhées de l’enfant dans les pays en développement, soutenues par : l’OMS (Vietnam), la Communauté Européenne (Burkina Faso) et le Ministère français des Affaires Etrangères (Algérie).
En France, nous avons mis en place un réseau hospitalier de surveillance des infections à Campylobacter avec l’aide du Groupe d’Etudes Epidémiologiques et Prophylactiques (GEEP). Ce réseau soutenu par le Ministère de la Santé dès 1986 a permis d’obtenir les premières données épidémiologiques sur cette infection dans notre pays, et notre laboratoire est devenu Centre National de Référence depuis 1993. En 2002, le système de surveillance a été étendu aux laboratoires de ville.
Helicobacter pylori a été découvert en 1982, et classé initialement dans le genre Campylobacter. Pour cette raison, nous avons été amenés à étudier cette bactérie qui avait une niche écologique différente de celle des autres Campylobacters. C’est seulement en 1989 qu’un nouveau genre a été créé pour cette bactérie avec comme espèce principale H. pylori.
Le CNR des Campylobacters et Hélicobacters est hébergé administrativement par le CHU de Bordeaux depuis sa re-labélisation en 2017.
Les CNR :
Historique
Les Centres Nationaux de Référence (CNR) ont été créés par un arrêté du 18 avril 1972 paru au Journal Officiel. Cet arrêté désignait des laboratoires experts pour la lutte contre les maladies bactériennes et virales avec notamment pour missions : l’identification, la collection de souches, la préparation d’immunsérums de référence et l’alerte.
La contribution des CNR à la surveillance épidémiologique a été confirmée par l’arrêté du 24 mars 1987 puis remplacé par l’arrêté du 7 octobre 1996 et deux catégories de CNR ont été définies : ceux qui n’avaient que cette mission d’ordre épidémiologique et ceux qui avaient en plus les missions des laboratoires.
Les CNR ont été sous la responsabilité unique de la Direction Générale de la Santé jusqu’en 1992, et leur nombre a augmenté jusqu’à 40.
Les premiers CNR étaient essentiellement des laboratoires de l’Institut Pasteur de Paris. Des laboratoires hospitalo-universitaires et d’autres institutions y ont été progressivement intégrés.
En 1992, le Réseau National de Santé Publique (RNSP) a été créé pour renforcer la sécurité sanitaire dans notre pays, l’investigation d’épidémies, la gestion et l’analyse des maladies transmissibles. Pour cette raison, les CNR sont venus compléter le dispositif de surveillance du RNSP.
Par arrêté du 29 juin 2001, une nouvelle procédure de recrutement des CNR a été mise en place et un cahier des charges publié. Ainsi, 42 CNR ont été créés ou reconduits.
Depuis le RNSP est devenu l’Institut de Veille Sanitaire (InVs), puis Santé Publique France. Un nouvel arrêté relatif aux CNR a été publié le 5 mai 2002 et complété par l’arrêté du 8 octobre 2002. Le CNR a été renouvelé en 2006-2010 et 2012-2016. Depuis début 2017, le CNR est passé sous gestion du CHU de Bordeaux pour la période 2017-2021.
Missions
En fonction de leur type d’activité, les Centres Nationaux de Référence (CNR) pour la lutte contre les maladies transmissibles ont des missions :
- d’expertise concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux : confirmation de l’identification et typage des souches adressées par les laboratoires d’analyses et de biologie médicale ; maintien, détention et diffusion des techniques de diagnostic, d’identification et de typage. Ceci comprenant constitution et entretien de collections de souches types, d’antigènes ou immun-sérums de référence, de marqueurs épidémiologiques.
- de contribution à la surveillance épidémiologique (surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections, résistance aux anti-infectieux, couverture immunitaire…). Les CNR participant à la surveillance d’une infection doivent au minimum répondre à des items bien définis par le cahier des charges défini dans l’arrêté du 29 juin 2001. A cette fin, ils fournissent à leurs correspondants les fiches de renseignements épidémiologiques et cliniques relatifs à leur domaine d’intervention.
- d’alerte c’est-à-dire signalement de phénomènes anormaux à Santé Publique France telles des épidémies, l’émergence ou la résurgence d’agents infectieux. Par exemple, cas groupés de Salmonelles ou Listeria de mêmes sérotypes, épidémies hospitalières à staphylocoques, ou cas isolés de maladies graves avec ou sans risques de contagion (méningites, rage, botulisme, choléra, fièvres hémorragiques virales, …). Ce rôle d’alerte s’exerce notamment dans le contexte du bioterrorisme (charbon, peste, brucellose, tularémie…).
- de conseil auprès des pouvoirs publics (ministère en charge de la santé) et des professionnels de santé.
Autres fonctions
Rôle de formation par un transfert de connaissances exercé de manière permanente par l’accueil de stagiaires français et étrangers, conférences, colloques.
Partenaires
Pour exercer leurs missions, les CNR établissent des collaborations nationales et internationales avec notamment les laboratoires de biologie médicale publics ou privés (LABM), des médecins organisés en réseau sur la base de programmes de surveillance bien définis, tels que Santé Publique France dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, les directions ou services de l’administration sanitaire, des laboratoires de recherche, des laboratoires industriels.
En envoyant à chaque Centre National de Référence le matériel biologique et les renseignements épidémiologiques de sa spécialité, les biologistes médicaux participent donc de façon primordiale à ce programme de lutte contre les maladies transmissibles.
Au niveau international, la plupart sont membres de réseaux européens ou internationaux.
Prix Nobel de Médecine 2005 pour la découverte de Helicobacter pylori :
- 3 octobre 2005: Traduction des attendus de la décision du Jury Nobel (PDF)
- 10 décembre 2005: Traduction du discours prononcé lors de la remise du Prix Nobel (PDF)
Autres sites d’intérêt :
Campylobacter
- En français:
- En anglais:
Helicobacter
- En français:
- En anglais:
Autres
- Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
- www.santepubliquefrance.fr
- Ministère de la Santé
- Société Française de Microbiologie (SFM)
- Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses – ex-AFSSA)
- Collège de Bactériologie, de Virologie et d’Hygiène des Hôpitaux
- Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques (ONERBA)
- United European Gastroenterology Federation (UEGF)